Le territoire qui correspond à la Communauté Pastorale de Loudéac a un riche patrimoine.
Eglise et chapelles de la paroisse d’Uzel
Eglise et chapelles de la paroisse de Collinée
Eglise et chapelles de la paroisse de Collinée sur Pninterest.
Eglises et chapelles de la paroisse de Loudéac
Eglises et chapelles de la paroisse de Loudéac sur Pinterest.
Eglises et chapelles de la paroisse de Merdrignac
Eglises et chapelles de la paroisse de Mûr-de-Bretagne
Eglises et chapelles de la paroisse de Plémet
Eglises et chapelles de la paroisse de Plouguenast
Le doyenné de Merdrignac pendant la période révolutionnaire
© InfoBretyagne.com Illifaut _Cette paroisse relevait de l’évêché de Dol. En 1789, elle avait pour recteur un Maufrais qui y était depuis 18 ans.
Le 20 février 1791, sommé par la municipalité de prêter le serment constitutionnel, il refusa noblement avec son vicaire. Mais plus tard il changea d’avis, et, le 17 juillet 1791, à l’issue des vêpres, au pied de l’autel, il prêta serment, en présence du sieur Bergé, lieutenant de la gendarmerie nationale de Broons, et du sieur Durant, gendarme, etc. Etait-ce lâcheté, ignorance ou débilitation mentale ? Toujours est-il qu’à partir de ce moment il tomba en enfance et mourut, en 1792, sans s’être réconcilié avec l’Eglise (…)
Le patrimoine de Plemet
La nouvelle commune compte quatre monuments historiques.
Les Saints fondateurs de la Bretagne
Les Saints fondateurs de la Bretagne
Selon la tradition et selon une vie de saints (hagiographie) tardive, écrite à partir du XIe siècle, les sept saints fondateurs de la Bretagne seraient des moines et ermites venus du Pays de Galles et de Cornouailles vers le 5e siècle et le 6e siècle, à l’époque de l’émigration bretonne (Grande Bretagne). L’évangélisation de notre province (Armorique) se serait alors établie autour des monastères fondés à cette époque.
St Tugdual (Tudal, Tual, surnom Pabu ) fêté le 30 novembre.
Évêque de Tréguier au VIe siècle - Diocèse de St Brieuc et Tréguier ; Département des Côtes d’Armor.

St Tugdual est le patron de Tréguier, ancienne ville épiscopale jusqu’à la Révolution (ville appelée « Landreger en breton au confluent des rivières Le Guindy et Le Jaudy) ») ; De nombreux lieux portent son nom : Pludual, Landual, St Thual, Landudal, Pabu ou St Pabu, St Tudwal au Pays de Galles. Il faut y ajouter le patronyme Tual ou Thual.
Tugdual était né vers la fin du Ve siècle au Pays de Galles, d’une famille de chefs locaux. Sa mère, Pompaïa, était devenue une sainte populaire. Elevé dans une école monastique, il devint moine, puis Abbé du monastère. Mais un ange lui apparut et lui demanda de se rendre en « Petite Bretagne » (la Domnonée ou Armorique à l’époque). Il traversa la Mer Bretonne avec quelques compagnons pour s’établir près du Conquet (Finistère). Puis il fut appelé par son cousin Deroch, arrivé avant lui ; pour fonder un monastère à l’embouchure du Guindy et du Jaudy au lieu-dit « Landreger », aujourd’hui Tréguier.

Sa vie, selon la tradition et/ou la légende, est remplie de faits extraordinaires et de « miracles ».Il évangélisa toute la région et la chrétienté se développait rapidement. Tugdual dut se plier à la volonté des fidèles et devint évêque en 532. Mais il se méfiait du chef de la Domnonée, Conomor (personnage peu recommandable dont il est question dans le Son-et-Lumière de l’abbaye de Bon Repos). C’est alors qu’il laissa son évêché et partit pour Rome où le pape venait de mourir. Le peuple romain, voyant une colombe se poser sur sa tête, le proclama pape sous le nom de « Léo V Papa Britigenus », d’où son surnom de « Pabu ». Mais, au bout de deux ans, ilregagna sa ville et son siège épiscopal où il faisait des merveilles. Il mourut probablement le 30 novembre 553 et continuait à faire des miracles. À l’arrivée des Vickings, ses reliques furent transportées en 878 à Laval, puis à Chartres. Elles revinrent enfin à Tréguier où des mains pieuses les sauvèrent des profanations de l’époque révolutionnaire. Il est toujours possible de les visiter à la cathédrale de Tréguier. Il faut noter cependant, qu’un autre saint fait la renommée de Tréguier ; il s’agit bien sûr de St Yves. Mais nous en reparlerons une autre fois.
Michel Blanchard (d’après différentes sources)
Les Saints de nos paroisses
Les SAINTS de nos paroisses À Langast et Querrien (La Prénessaye) Saint Gall (ou Gal) Ermite missionnaire et moine itinérant. Fêté le 16 octobre.

C’est le plus célèbre des 12 compagnons moines de St Colomban venus du monastère de Bangor d’Irlande pour évangéliser la Gaule au 6e siècle. Après un passage en Angleterre, Colomban et ses douze disciples traversèrent la Manche pour porter la bonne parole du Christ ressuscité. Ils fondèrent un monastère dans les Vosges et atteignirent la Rhénanie actuelle et la Suisse. Vers 585, persécutés, ils durent fuir, et ils arrivèrent en Gaule celtique. Ils créèrent une nouvelle communauté à Luxeuil (Bourgogne). À nouveau expulsés et, après une longue marche, les moines missionnaires arrivèrent en Armorique à Nantes où, pour des raisons diverses, Gal et Colomban se séparèrent.
Nous retrouvons St Gal à Langast (autrefois Langal). Au village du Montrel, il fonde un ermitag puis il se rend à Querrien où il fait jaillir une source pour alimenter le village. Il sculpte une statue de la vierge à l’enfant et la place dans un oratoire en bois. Dix siècles plus tard, à Querrien, l’oratoire a disparu mais la fontaine St Gal et la mare St Gal pour les animaux sont toujours là, rappelant son passage. Et lors des apparitions, en 1652, la Vierge, comme signe manifeste de sa présence à l’adresse des villageois, précisera à la petite Jeanne Courtel « Va leur dire de creuser la mare St Gall. Ils y trouveront mon image ».
Aujourd’hui St Gal est devenu l’exemple des prêtres prédicateurs missionnaires porteurs de la Bonne Nouvelle.
En Suisse il est le saint patron de multiples églises et chapelles. Une ville porte son nom.
Chez nous, à Langast, la paroisse lui est dédié et au village du Montrel, où il a son pardon, il est fêté chaque année.
Enfin depuis 2018, grâce aux donateurs de la ville de St Gall et à l’association du Montrel, sa statue orne la vallée des Saints (Carnoët). Le sculpteur l’a présenté sous son ermitage avec un ours. La légende nous dit qu’il avait la faculté d’adoucir la férocité des animaux sauvages. Pour les chrétiens, il reste d’abord l’ermite prédicateur itinérant de l’évangile.
En 2012, le pape Benoît XVI soulignait que la mémoire de St Gal « invitait à réfléchir sur l’urgence de l’évangélisation en Europe ». Tout un programme.
Les Saints de nos paroisses
Les SAINTS de nos paroisses
Saint-Yves, Co-Patron de la Bretagne Figure emblématique du diocèse Décédé en 1303 - Canonisé en 1347 - Fêté le 19 mai
Avec Ste-Anne, honorée en juillet, c’est assurément St-Yves qui, en mai, rassemble nombre de bretons de par le monde, fête populaire ou religieuse !
Églises et chapelles lui sont dédiées !- en Bretagne d’abord, surtout dans le Trégor et le Goélo, mais aussi à Rome, dans les territoires d’outre-mer et même au Canada. À St-Brieuc, la Maison St-Yves, abritant les structures diocésaines, l’évêché, la médiathèque et un accueil de jour, est devenue pôle de référence.
Et, signe assez étonnant, son prénom, en breton comme en français, se décline dans une incroyable diversité.
Dom Yves Héloury (St-Yves) est né à Minihy, commune près de Tréguier au Manoir de Kermartin. Élève brillant, il part pendant 6 ans, étudier les lettres à Paris pour devenir prêtre. À Orléans ensuite, il approfondit le droit romain, le droit canon et la théologie puis il revient au pays. Nommé en paroisse, il est vite reconnu pour sa simplicité, ses talents d’orateur, prêchant la Bonne Nouvelle dans tout le Trégor. Nommé également « official » -juge ecclésiastique du diocèse - il se fait connaître par son esprit de conciliation et de justice, défenseur des plus pauvres, gratuitement, les recevant au manoir familial et partageant ses vêtements. Il mène une vie d’ascèse, exemple d’humilité.
Sa statue le représente tenant dans une main le parchemin de la justice et dans l’autre la bourse, le sac ou l’aumônière, symboles de cette volonté de partage vers les plus humbles. À ce titre, St-Yves est devenu le saint patron de toutes les professions de justice et de droit notamment celle des avocats. Une délégation importante de ces professions accompagne chaque année le grand pardon. Et à Tréguier, le Fonds St-Yves conseille bénévolement.
Un pardon exceptionnel à Tréguier (sauf contraintes sanitaires) Chaque année, un pardon exceptionnel a lieu en mai, c’est le second grand pardon de Bretagne après celui de Ste Anne. Des milliers de pèlerins. Une procession très spécifique vers Minihy. Les paroisses du Trégor et du Goélo toujours présentes avec croix et bannières. Le Chef de St Yves, conservé à la cathédrale, est porté ce jour-là suivant un rituel bien réglé, avec prières, cantiques bretons et français alternés résumés dans ce refrain.
« St-Yves, notre père, toi que nous implorons entends notre prière et bénis tes bretons »
Les SAINTS de nos paroisses
Et deux St Maurice sur la zone pastorale
St Maurice d’Agaune - ou du Valais - Martyr au 3e siècle Un hameau du Quillio et sa chapelle.

De nombreuses villes ou villages portent aussi ce nom en Savoie, ou en Suisse. À l’époque des persécutions, l’empereur Dioclétien, fit venir de Thèbes en Égypte - aujourd’hui Louksor - une légion romaine - d’où l’appellation parfois de légion thébéenne - et ce dans le but d’exterminer des chrétiens de Gaule. Agaune se situe aujourd’hui dans le Valais suisse. Les légionnaires, sans doute coptes, refusèrent d’obéir et furent exécutés à leur tour en l’an 286. Maurice était l’un d’eux apparemment officier, chef de groupe le premier dimanche qui suit le jeudi de l’Ascension, mais les règles sanitaires, en vigueur à ce jour, ne permettent pas leur reconduction. St Maurice est également le patron des chasseurs alpins, des gardes. On le représente, le plus souvent, avec les attributs du soldat romain, casque et cuirasse, debout ou à cheval. L’association du hameau a relancé, ces dernières années, pardon et festivités suisses et de certains régiments d’infanterie
St Maurice, vénérable, moine cistercien, 12e siècle Père Abbé de Langonnet puis de Carnoët Un hameau de Loudéac et sa chapelle. Second patron de la paroisse !

Maurice Duault est né à Croixanvec – près de Loudéac - et sa famille est venue habiter le village qui porte maintenant son nom. Fils de paysans, après des études sérieuses à l’Université de Paris, il est prêtre à 23 ans. Mais le désir de la solitude l’emporte et il entre à la toute nouvelle abbaye de Langonnet. Il en fut le premier abbé en 1142 et le restera pendant plus de trente ans. On lui demanda ensuite en 1175 de fonder un autre monastère dans la forêt de Carnoët. Il en sera l’abbé pendant 14 ans et en fera un foyer de grand rayonnement. Il décède le 29 septembre 1191.Pendant toutes ces années, sa grande sagesse et sa droiture vont faire sa renommée et un véritable élan de ferveur s’instaure dans le peuple, de nombreux bienfaits lui étant attribués. Son culte fut confirmé par Clément XI et c’est pourquoi, avec St Nicolas, il est devenu en quelque sorte l’autre patron de la paroisse. Leurs deux statues encadrent le retable central du chœur de l’église. On le voit ici sur un vitrail de la chapelle représenté en père abbé avec crosse et livre ouvert. Mais un autre détail intéressant marque aussi cette chapelle restaurée : Un des vitraux du 16e représente également le légionnaire romain honoré au Quillio ! Ainsi, clin d’œil de l’artiste, les deux St Maurice sont réunis dans une même évocation lors du pardon qui se déroule en principe le deuxième dimanche de juillet.
Les SAINTS de nos paroisses
Les SAINTS de nos paroisses
SAINT LOUIS-MARIE GRIGNON DE MONTFORT À LA « CHEZE »
Aîné de dix-huit enfants, Louis Grignion de La Bacheleraie naquit à Montfort-la Cane

(Montfort-sur-Meu) le 31 janvier 1673, en plein 17e siècle. Il était le fils d’un avocat, mais par esprit d’humilité, il abandonna le nom de sa famille pour prendre celui de son lieu de naissance. Sa première éducation fut pieuse et forte chez les Jésuites de Rennes. Et à 19 ans, il entra au séminaire Saint-Sulpice à Paris. Ordonné prêtre en 1700, Il devient aumônier de l’hôpital de Poitiers. Il partage alors la table des pauvres malades et regroupe les jeunes filles désireuses de servir les pauvres, dont Marie-Louise Trichet qui deviendra la première supérieure des Filles de la Sagesse. Les missions attirent Louis-Marie. Il se rend à Rome pour voir le pape qui l’envoie en mission dans l’ouest de la France.
C’est en 1707 que Louis-Marie arrive dans notre région. Il se joint à une vingtaine de prêtres, qui sous la direction de Jean Leuduger, prêtre de Plérin, fondateur des Filles du Saint-Esprit, « prêchent » des missions dans les campagnes. C’est la première vraie rencontre de Montfort avec un peuple enthousiaste. « Son lit était de pierre et trois fagots. Ses chemises teintées de sang faisaient voir qu’il ne s’épargnait pas la discipline. Toujours gai dans les adversités. Louis se révèle un animateur de foules et il n’a pas peur des entreprises audacieuses ;… » Le groupe Leuduger travailla dans les diocèses de Saint- Malo et de Saint- Brieuc et Louis arrive à La Chèze où la chapelle Notre-Dame de Pitié tombe en ruines depuis des siècles. Une tradition locale rappelle une prophétie de Saint Vincent Ferrier, qui, en 1417, prévoit la venue d’un homme inconnu et bafoué ; cet homme reconstruirait la chapelle. Louis n’hésite pas à assumer l’héritage mystérieux : « Je suis cet homme. » Il devient architecte et contremaître de chantier, et avec le concours du peuple, il construit l’église paroissiale actuelle St-André… » Il s’attache profondément à ce lieu, à l’église et au peuple qui le suit (1). Il poursuit sa mission dans les alentours à Plumieux et à La Ferrière où il va porter la Bonne Nouvelle aux ouvriers qui extraient le minerai de fer dans le bois, dit « du Minerai » et où la tradition situe le « préchoué » sur un talus. D’ailleurs il avait une chambre dans le manoir de La Grange à La Chèze, qui existe toujours et peut être visitée. Il y séjourna de février à novembre 1707
Il poursuivit ensuite sa mission en Normandie et en Vendée. Il fit édifier le

calvaire de Pont-Château (Loire-Atlantique), détruit à la Révolution, mais reconstruit depuis. Arrivé à Saint-Laurent-sur-Sèvre en 1716 et épuisé par une telle dépense d’énergie, il y mourut le 28 avril 1716, à l’âge de 43 ans. C’est dans ce lieu que se trouve son tombeau aujourd’hui, dans la basilique. St Jean-Paul II, qui avait adopté sa devise « Totus Tuus » (« Tout en tous ») vint en pèlerinage à son tombeau en 1996. Louis-Marie avait une grande dévotion pour Marie. On lui doit « Le traité de la vraie dévotion à Marie » et il composa un certain nombre de cantiques sur des airs populaires, par exemple « Oh ! l’auguste Sacrement » que nous chantions encore il y a quelques 50 ans. Il est également le fondateur des congrégations des Pères Montfortains, des Sœurs de la Sagesse et des Frères de St Gabriel dont la Maison-Mère est à St-Laurent sur Sèvre en Vendée.
(1) Extrait de « L’homme venu du vent » de Benedetta Papasogli.
Les SAINTS de nos paroisses SAINT ADRIEN
Les SAINTS de nos paroisses SAINT ADRIEN
Chapelle (en ruine) et Calvaire, à Allineuc Saint Adrien désigne plusieurs saints chrétiens.
Adrien de Nicomédie était officier dans l’armée de l’empereur romain Galère qui faisait

appliquer avec zèle les quatre édits de persécution des chrétiens de Dioclétien. Vers 306, alors qu’Adrianus avait vingt-huit ans, il se convertit devant le courage de trente-trois chrétiens de Nicomédie (actuellement Izmir en Turquie), que Galère avait ordonné de supplicier.
Apprenant cette conversion, l’empereur fit emprisonner Adrianus avec les autres chrétiens puis, quelque temps après, le fit comparaître devant lui en présence de ses compagnons pour le faire fouetter. Puis Adrianus et ses compagnons furent de nouveau jetés en prison. En 306 l’empereur Galère ordonna qu’on torture les prisonniers, puis qu’on fasse brûler leur corps. Adrianus fut le premier supplicié. Quand on jeta le corps d’Adrien au feu, son épouse Nathalie voulut se précipiter dans le brasier mais une pluie violente éteignit les flammes. Saint Adrien est fêté le 8 septembre. Il est le saint patron des soldats, mais il est également invoqué contre les maux de ventre.
Adrien de Césarée arrive en Palestine avec saint Eubule, pour rejoindre les confesseurs de la foi. Vers l’an 310, ils y furent arrêtés, torturés et condamnés à être livrés aux bêtes. Adrien fut présenté seul à un lion, puis égorgé. Deux jours plus tard, Eubule affronta les bêtes à son tour.
Adrien III fut pape pendant seulement 18 mois, de 884 à 885. Il mit tous ses efforts à réconcilier l’Église de Constantinople avec l’Église romaine avant de mourir saintement d’une grave maladie.
Adrien de Cantorbéry né en Afrique, moine et abbé près de Naples, vint en Angleterre en 710, où il fut nommé abbé du monastère Saint-Pierre-et-Saint Paul qu’il gouverna durant trente ans. Il fut ainsi un collaborateur efficace de Théodore, évêque de Cantorbéry, dans une étape décisive de l’histoire de l’Église d’Angleterre.
Une commune porte le nom de St Adrien près de Guingamp. Plusieurs chapelles en Bretagne sont également dédiées à St Adrien.
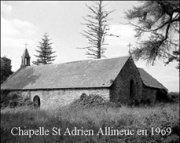
Chez nous, la chapelle d’Allineuc, construite au 18e siècle, fut un lieu de

pardon jusqu’en 1963. Elle est actuellement en ruine et les statues de la Vierge, de St Adrien et de St Roch ont disparu. Mais le Calvaire à proximité a été restauré depuis peu et c’est là, au sommet de la colline, que se rassemblent chaque année des chrétiens des environs pour le chemin de Croix du vendredi Saint.
Les SAINTS de nos paroisses Saint Cornély
Les SAINTS de nos paroisses
SAINT CORNÉLY
Saint Cornély, ou Corneille, (en latin : Cornelius), est issu d’une famille romaine noble. C’est le 21e pape de
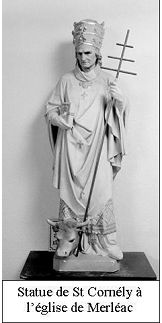
l’Église. Son pontificat ne dura que deux ans, de 251 à 253. Pendant la persécution de Gallus, il est exilé et meurt à Civita Vecchia. Il est fêté le 16 septembre comme saint par les Églises catholiques et orthodoxes. Dans le sud de la Bretagne, saint Cornély (Sant Korneli en breton), dit aussi Carneli ou Korneli, est le plus connu des saints protecteurs du bétail. Il est prié dans de nombreuses chapelles en Bretagne, par exemple à Plouhinec, Languidic, Péaule, et surtout à Carnac où un grand pardon a toujours lieu en septembre
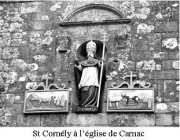
Selon une légende bretonne, née d’une assonance entre Cornély et Carnac, il aurait fait surgir les alignements de Carnac en transformant en menhirs une armée de soldats païens. Cornély était en effet poursuivi par des soldats païens. Deux bœufs l’accompagnaient qui portaient ses bagages. Un soir, il arriva devant la mer. Les soldats le serraient de près, rangés en bataille. Il se cacha dans l’oreille d’un bœuf et transforma ses ennemis en pierre. C’est pourquoi les alignements mégalithiques de Carnac sont parfois appelés « Soudarded sant Korneli » (soldats de saint Cornéli). C’est pour cette raison aussi que Saint Cornély est le protecteur des bêtes à cornes.
Chez nous, à Merléac, il n’y avait pas (ou plus ?) de chapelle Saint Cornély, mais l’abbé CONNAN, recteur de la paroisse, a relancé la fête de Saint Cornély après la dernière guerre. On peut lire dans son bulletin du 15 juillet 1951 :
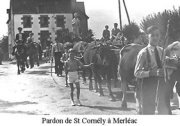
« Le Pardon de Saint Cornéli aura lieu le 19 août. Il sera présidé par Monsieur le chanoine Crézé, ancien curé de St Michel à St Brieuc. Il nous reste un mois pour le préparer. J’espère compter sur le dévouement et le concours de tous mes paroissiens… Le Pardon et la kermesse qui le suit, ne sont pas et ne doivent pas être uniquement l’affaire de votre recteur (à qui ils n’occasionnent que soucis, travail, fatigue), mais une affaire paroissiale… Le programme ? Le même que les années précédentes. Une innovation cependant, à la procession, on portera les reliques de Saint Cornéli renfermées dans le joli reliquaire que vous connaissez… »
La statue du Saint était transportée sur une charrette tirée par des bœufs. Ce pardon a duré jusque dans les années 60. Récemment, la place centrale du bourg a été baptisée « Place St Cornély » . Joseph Martin
Les SAINTS de nos paroisses La vie de…
Les SAINTS de nos paroisses
La vie de SAINT-THELO

L’évêque Thélo, devenu Saint Thélo a réellement existé. Différentes recherches historiques permettent de l’affirmer, en particulier un texte très ancien « Le livre de Landaff » traduit du celte à la fin du XIXe siècle par des religieux de Quimper.
Un jeune homme pieux, travailleur et visionnaire Thélo (ou Théliau) serait né au Pays de Galles vers l’an 485. Elève de Saint-Dubrice archevêque de Landaff, le jeune Thélo se distingue vite par sa soif de connaissances et son art de la parole. Plusieurs prodiges lui sont prêtés dès ces plus jeunes années ; comme le dressage de deux cerfs dans la forêt de Landaff pour lui permettre de ramener au monastère indispensable pour l’hiver. Vers l’an 510 Thélo traverse la Manche et est accueilli à Dol par l’archevêque Samson. Bras droit de Saint-Samson, Thélo travaille énormément. Il encourage les paysans à apporter des améliorations aux cultures et à l’élevage par le défrichement des bois et des landes ; il fait construire des routes et plante de nombreux arbres fruitiers. L’on affirme que ce serait une branche de pommier ramenée par Thélo du Pays de Galles qui serait à l’origine des beaux pommiers qui vont fleurir ensuite en Bretagne.
Thélo et la paroisse qui porte son nom. Au retour d’un pèlerinage à Jérusalem il aurait rendu visite à sa sœur Aneumède épouse du roi Budic de Carhaix. Au retour, pour rejoindre Dol, il se serait reposé sur les bords de l’Oust chez des moines installés dans un lieu appelé Onon. Vers l’an 1000 lorsque le comte de Porhoët accepte la création d’une paroisse autour des terres d’Onon, les moines lui donnent le nom de Saint-Thélo.
Prodiges, miracles et mystères Saint-Thélo est souvent représenté chevauchant un cerf et entouré de pommes ou de pommiers. D’autres prodiges lui sont également attribués ; comme la guérison de paralytiques par la parole et l’imposition des mains ou encore la connaissance immédiate des langues parlées par tous ceux qu’il rencontre au cours de ses voyages. Il aurait aussi délivré la Bretagne d’un monstre sanguinaire simplement en lui posant autour du cou une étole de soie. Docile, le monstre se serait laissé emmener par Thélo vers la mer où il aurait à jamais disparu.
Les paroisses bretonnes de Saint-Thélo D’autres paroisses bretonnes l’honorent également : Montertélo (Monter-Théleau) au sud de Ploërmel, Plédéliac (Plou-Théliau) près de Lamballe, Landeleau (Lan-Thélau) près de Châteauneuf du Faou. Et aussi Plogonnec où existe sur la route qui mène à Locronan une très belle chapelle dédiée à notre saint patron. Et dans la Vallée des Saints à Carnoët une grande et belle statue en granit lui est dédiée.
Le « Livre de Landaff » situe la mort de Saint-Thélo en l’an 565, à l’âge de 80 ans. Il est honoré ici le premier dimanche de février. Francis Blanchard
Les SAINTS de nos paroisses SAINT CARADEC
Les SAINTS de nos paroisses
SAINT CARADEC (paroisse de Loudéac)
La Commune et le relais portent aussi son nom
Sous des appellations légèrement modifiées, Caradoc, Carannog, Karanteg, le Pays de Galles, l’Irlande ou l’Écosse honorent également ce saint aux origines religieuses discutées. En Bretagne, plusieurs paroisses, des chapelles en nombre suffisent à prouver combien son culte était répandu en Armorique. Alors, et chez nous à St Caradec ? Oui, mais lequel ? Plusieurs St Caradec ou St Carantec se sont confondus au fil de l’histoire, de la tradition, ou de la légende, et ce saint fait partie aujourd’hui des saints Bretons plus ou moins reconnus par l’Église, mais il est bien présent, y compris maintenant dans la « Vallée de Saints ».
En simplifiant les légendes successives, nous pouvons résumer ainsi : Caradec serait né au Ve siècle dans l’ile de Bretagne (Grande-Bretagne) et plus vraisemblablement au Pays de Galles. Suite à une invasion des Scots, venus d’Islande, les guerriers bretons partirent en guerre contre l’envahisseur mais leur roi étant âgé, ils demandèrent à son fils Caradoc de prendre la tête de leurs troupes. Mais voilà ! Caradoc, résolu à se consacrer au service de Dieu, et préférant le royaume céleste à celui terrestre, refusa et la royauté et la guerre. Il se serait alors enfui, et devenu ermite, se serait consacré à la prière, loin des soucis des humains. Beaucoup plus tard, changement de cap. Nous le retrouvons moine pèlerin, en Irlande, où il aurait alors fondé un monastère et réussi à convertir à son tour un chef de tribu. Il n’est pas certain qu’il soit venu en Armorique, mais les migrations successives l’ont fait connaître et ont répandu son culte.

À St Caradec, sur le placître de l’église fort bien aménagé, sa statue se dresse majestueusement avec tous ses attributs. Évêque ou Prieur de monastère, il n’est pas précisé ! L’église, remarquable à l’extérieur par ses pinacles, sa tour cloché et sa tourelle, possède, à l’intérieur, un chemin de croix original sur schiste ardoisier et surtout une crypte devenue célèbre, abritant une statuaire reconnue de la mise au tombeau du Seigneur. Chaque Vendredi Saint les fidèles de la zone pastorale se réunissent pour prier et rappeler cette inhumation. À visiter
Le relais paroissial n’a pas conservé, malheureusement, le pardon pour la fête de St Caradec. Il se déroulait aux alentours du 16 Mai. Mais son cantique du 19e, conservé dans les archives paroissiales, rappelle en détails, sous forme de complainte, toute cette histoire.
Christian Duault - Michel Hinault
Les SAINTS de nos paroisses Saint Connec
Les SAINTS de nos paroisses
SAINT CONNEC

Saint-Connec vient de Conec (ou Conech, Connoc, Konog). On le retrouve aussi à Plogonnec (plo signifie paroisse), ou à Thégonnec (le Té exprime le style familier). Connec serait un moine du VIe siècle, disciple de Pol Aurélien. Originaire de Cambrie (Pays de Galles). Il a traversé la mer avec son abbé vers 512. Pol l’a chargé de diriger en son absence le monastère créé à l’Ile de Batz. Il en est le père « prieur » en quelque sorte ; on l’appelle le « Maître des moines », ce qui ne veut pas dire le maître des novices. En dépit de la statue qui en fait un archevêque, aucune preuve n’existe qu’il fut autre chose qu’un moine, un moine qui établit peut-être un « lan » ou un « loc » à l’emplacement de cette paroisse dont il est toujours le saint patron.
Saint Thégonnec a sa statue à la Vallée des Saints. D’après la légende, Thégonnec avait apprivoisé un cerf avec lequel il allait chercher des pierres dans la montagne à

Plounéour-Ménez pour construire une église. Un loup ayant agressé et tué son cerf, Thégonnec convainquit le loup de se laisser atteler au chariot pour finir le transport des pierres. Ce miracle incita la population à l’aider dans l’œuvre entreprise. Une légende qui ressemble curieusement à celle de Saint Hervé avec son âne.
La statue au-dessus de l’entrée principale de l’église de St Thégonnec représente aussi cette légende. Saint Thégonnec y est représenté avec une bête à cornes attelée et était considéré localement comme protecteur des ruminants, concurremment à saint Cornély.
Connec fut assez connu pour être encore honoré dans de nombreuses localités de Bretagne (Rosconnec, Briec, Guerlesquin, Saint-Connec, Quessoy, Plouguernével, Plourhan, etc.).
En fait, la commune de St Connec, près de Guerlédan, honore plutôt Saint Gonnéry,
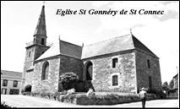
saint patron de la paroisse, venu d’Irlande au VIe siècle. Au début du XXe siècle, la lecture de manuscrits du XVIe avec leurs différentes orthographes (Conec, Connec, Gonner, pour arriver à Gonnery) a fait confondre les deux Saints.
La commune de Saint Connec célèbre le pardon de Saint Gonnéry chaque année vers le 15 juillet.
Joseph MARTIN
Les SAINTS de nos paroisses SAINT GUEN
Les SAINTS de nos paroisses SAINT GUEN
L’origine du mot « Saint Guen » a été discutée et on peut encore le faire. Les hypothèses à ce sujet sont aussi nombreuses que les écritures du nom (Gwen, Gwénaël, Guénaël, Guénault, Guinal, Gwendal, Guennal, etc).

La paroisse et l’église Saint Guen de Vannes sont dédiées à un saint breton du 6e siècle, Saint Gwénaël, abbé de Landévennec et successeur en 532 de Saint Guénolé. Celui-ci l’aurait rencontré dans une rue de Quimper et obtenu de ses parents qu’il vienne étudier sous sa direction. Il aurait restauré plusieurs monastères en Irlande, mais son culte s’est surtout répandu dans l’ouest de la Bretagne. L’église d’Ergué-Gabéric (Finistère) lui est dédiée sous le nom de saint Guinal, ce qui fait penser qu’il serait né dans cette commune. Il aurait fondé un monastère à Caudan, où l’on voit une chapelle Saint Guénaël, et y serait mort vers 590. L’extension du culte chrétien en Bretagne a pu faire apparaître plusieurs « saints » du nom de Guen. La Vallée des Saints nous présente d’ailleurs une statue de Saint Gwénaël, une de Saint Guen et une de Sainte Gwenn. C’est, paraît-il, cette dernière qui serait à l’origine du nom de la commune de Saint Guen, rattachée depuis peu à Mûr pour former la commune nouvelle de Guerlédan. Sainte Gwenn, Sainte Blanche en français (mais autrefois les habitants de la région parlaient breton), a enfanté au moins trois saints, les jumeaux Guéthenoc et Jacut, puis Saint Guénolé. Elle est l’épouse de Saint Fragan, et ils vivaient au Ve siècle. Les époux et leurs deux premiers fils sont nés au Pays de Galles, leur pays d’origine. Le troisième fils serait né peu de temps après le débarquement de la famille en Bretagne, à l’embouchure de la rivière Brahec, au fond de la baie de Saint-Brieuc. Selon la légende, Dieu a accordé à Gwenn un troisième sein pour pouvoir allaiter ses triplés, d’où son surnom breton « santez Gwenn Teir Bronn », littéralement « la sainte aux trois seins ». Il s’agit d’une mauvaise traduction car en réalité seuls Guéthenoc et Jacut étaient jumeaux. Mais la dévotion populaire a entretenu cette légende et a toujours représenté Sainte Gwenn avec 3 seins, comme sur sa statue à la Vallée des Saints. Sainte Gwenn est la protectrice des enfants. Elle est aussi invoquée par les mères manquant de lait, et est la patronne des nourrices.

En fait, le nom de la localité de Saint Guen (Saint Djuin en gallo, Sant Wenn en breton) est très discuté. Il a peut-être encore pour origine Saint Guénégan qui était un évêque, ou un certain abbé Guen, ou encore un moine de St Tugdual, nommé Even.
Joseph Martin
Les SAINTS de nos paroisses SAINT Hervé
Les SAINTS de nos paroisses Saint Hervé

Hervé est un saint breton qui serait né vers 515 à Plouzévédé dans le Finistère actuel. Son père, le barde Hyvarnion, décide un jour de quitter la cour du roi Childebert pour retourner en Bretagne. Il y rencontre la belle Rivanone qui avait fait le vœu de chasteté. De leur union, un fils vient au monde, Hervé, mais, victime de la malédiction maternelle, l’enfant naît aveugle.
Les écrits sur la vie de St Hervé n’apparaissent qu’à partir du 13e siècle, et sont comme souvent enjolivés de nombreux faits extraordinaires. Voué par le destin à ne contempler que son monde intérieur, Hervé se retire de la société et choisit de vivre dans la solitude. Il serait le fondateur du monastère de Plouvien dont il devient l’abbé, et qu’il installe plus tard à Lan- Houarneau, localité où il serait mort vers 568. Ermite, aveugle et musicien, Hervé aurait œuvré pour l’éducation des enfants et l’accueil des pauvres sur le Menez-Bré.
La légende raconte que le chien avec lequel Hervé se guidait fut mangé par un loup ; le saint contraignit alors le loup à le remplacer ; c’est pourquoi à Trédaniel, Saint Hervé est représenté tenant un loup en laisse, et est invoqué surtout par les peuples voisins des forêts pour protéger leurs troupeaux. On lui attribue le fameux cantique breton (Cantique du Paradis en français) :
Jésus, qui vit aux cieux et règne près de Dieu, j’attends ton paradis car tu me l’as promis
Hervé est souvent représenté aussi en compagnie d’un jeune homme, son guide Guiharan. Un jour que saint Hervé laboure un champ avec son âne, un loup survient et dévore l’animal de trait. Selon la légende, Hervé ordonne à la bête féroce de prendre la place de l’âne qu’il vient de manger. Obéissant au saint, le loup vient simplement se mettre devant la charrue et achève de tracer ses sillons. C’est ainsi qu’il est représenté sur une toile dans l’église de St Hervé près d’Uzel, avec le loup tirant la charrue.

De nombreuses églises, chapelles et localités du Finistère et des Côtes d’Armor sont dédiées à St Hervé, comme à Ploufragan, Bothoa, Gourin, Plélauff, Crozon, Langouélan, etc., et bien sûr l’église de St Hervé près d’Uzel, commune appelée autrefois Hervé-le-Loup. Une association, du nom de « Les amis de Rivanone », restaure et entretien le patrimoine de cette église. Lors du pardon, le dernier dimanche de juin, on se met sous la protection du Saint en chantant
Les SAINTS de nos paroisses SAINT JACQUES
Les SAINTS de nos paroisses
SAINT JACQUES
Chapelles St Jacques à Merléac et à Plémet
Fils d’un homme appelé Zébédée et frère de saint Jean l’évangéliste, saint Jacques le Majeur était

pêcheur dans le lac de Tibériade. Il est un des apôtres les plus présents dans les Évangiles et les Actes des Apôtres. Avec Pierre et son frère André, Jacques et Jean faisaient partie du groupe de pêcheurs parmi lesquels Jésus choisit ses quatre premiers disciples.
Il intervient parfois de façon assez brutale, ce qui lui vaut d’être repris par Jésus qui le surnomme « Fils du tonnerre ». La tradition le nomme "Jacques le Majeur" pour le différencier d’un autre apôtre qui porte le même prénom, Jacques, fils d’Alphée, dit « le Mineur ».
Après la Pentecôte, selon la tradition, il part évangéliser l’Ibérie (future Espagne).Sa prédication ayant échoué, il rentre à Jérusalem où il obtient de nombreuses conversions. Contrarié du succès de Jacques, le roi de Judée, Hérode Agrippa, le fait décapiter, aux alentours des années 41-44. De nombreuses légendes se sont développées au cours des siècles suivants, enjolivant la vie et les hauts faits.
Ainsi, après son martyre, ses disciples auraient ramené son corps en Ibérie dans une barque qui, sept jours plus tard, s’échoua en Galice. Là ils se seraient opposés à Lupia ou Louve, reine de la contrée. Pour les empêcher d’inhumer leur maître sur ses terres, celle-ci leur aurait ordonné de le transporter dans un char tiré par des taureaux sauvages. Mais cette tentative échoua car, contre toute attente, les bêtes se seraient montrées dociles. La cérémonie de l’inhumation se serait alors déroulée sans autre incident et la reine et sa cour se seraient converties.
En 831, un ermite nommé Pélayo ou Pélage découvre le lieu de la sépulture de Jacques le Majeur : une nouvelle étoile apparue dans le ciel lui en indique l’endroit. L’emplacement de la sépulture, appelé dès lors campus stellae ou "champ de l’étoile" aurait donné le mot "Compostelle".

Les SAINTS de nos paroisses Sainte Suzanne
Les SAINTS de nos paroisses
SAINTE SUZANNE
Chapelle Sainte-Suzanne à Mûr-de-Bretagne
Suzanne vécut il y a vingt-cinq siècles à Babylone, où le peuple juif était retenu en exil.

C’était l’épouse d’un chef hébreu. Elle fut accusée d’adultère par deux vieillards et traduite devant un tribunal qui, après un simulacre de jugement, la condamna à mort par lapidation selon la loi de Moïse.
C’est alors que le prophète Daniel intervient et déclare que cette femme a été jugée sans preuve. Après un nouveau procès, où les deux accusateurs sont interrogés séparément, il est prouvé qu’ils ont menti. Suzanne est acquittée et les deux vieillards condamnés à mort.
Son histoire est racontée dans la Bible au Livre de Daniel, chapitre 13.

On peut se demander pourquoi cette sainte qui vécut 500 ans avant Jésus Christ et très loin de la Bretagne, soit honorée à Mûrde-Bretagne. Tout ce que l’on sait, c’est que son culte est ancien. Une chapelle existait autrefois sur le mont Ménéhiez. La chapelle actuelle, surnommée la petite chapelle Sixtine, fut commencée au XVe siècle. Les lambris de la nef peints au XVIIIe siècle représentent des scènes de la Passion du Christ ainsi que la vie de sainte Suzanne.
Le pardon de Sainte Suzanne a lieu le premier dimanche de juillet. Sainte Suzanne est la patronne des familles comme le rappelle le refrain du cantique :
Sainte Suzanne, à vous nos cœurs
À vous l’amour de nos familles
Qu’à nos foyers votre foi brille
Pour sanctifier tous nos labeurs. }}}
Une autre Suzanne, Suzanne de Rome, est honorée par exemple à Questembert. Elle vécut au 3e siècle. Devenue chrétienne, elle fit vœu de virginité. L’empereur Dioclétien voulait la marier à son fils Maximien et La faire se prosterner devant la statue de Jupiter, mais elle refusa, disant qu’elle se réservait à l’Eglise du Christ. Une fois la scène rapportée à l’empereur, celui-ci la condamna à mort par l’épée. Sa fête est célébrée le 11 août
Les Saints fondateurs de l’Europe
Les Saints fondateurs de la Bretagne Selon la tradition et selon une vie de saints (hagiographie) tardive, écrite à partir du XIe siècle, les sept saints fondateurs de la Bretagne seraient des moines et ermites venus du Pays de Galles et de Cornouailles vers le 5e siècle et le 6e siècle, à l’époque de l’émigration bretonne (Grande-Bretagne). L’évangélisation de notre province (Armorique) se serait alors établie autour des monastères fondés à cette époque.
SAINT MALO d’Aleth (Alet) ou Maclou ou Maclav
C’est sans doute le moins connu des sept saints fondateurs, même si la ville qui porte son nom, a une renommée internationale.

Tout d’abord, il ne faut pas le confondre avec un autre St Malo, l’un des soldats d’une légion romaine, mort martyr dans le Nivernais, avec ses compagnons, au 3e siècle, pour n’avoir pas voulu persécuter les chrétiens du pays. Le Malo que nous honorons en Bretagne, la tradition, dans l’Église catholique, le désigne sous le nom de St Malo, premier évêque d’Aleth ou d’Alet. Une explication s’impose alors à propos d’Aleth ! En effet, au 6e siècle, la ville de St Malo n’existait pas. La forteresse d’Aleth, depuis l’époque romaine, puis celle des celtes, était une cité forteresse, marchande ou militaire suivant les époques. Elle s’était développée et agrandie au fil des siècles pour devenir St Servan. Mais une autre agglomération toute proche allait naître autour de son port. Elle s’appellera St Malo ! Aujourd’hui, Aleth, ou, si vous préférez St Servan, avec sa Tour Solidor, c’est devenu un quartier de St Malo.
Saint MALO Ermite et Évêque Fêté lé 15 novembre
Malo est donc un prénom masculin, d’origine celtique avec des formes dérivées : Mallorie, Maloh, Malu.
La vie de Saint Malo, composée vers l’an 870 par le diacre Bili à Alet, le fait naître, vers l’an 510 à Llancarfan,
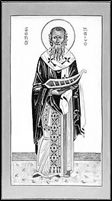
dans un royaume du Pays de Galles. Vers l’an 538, Malo va faire partie de l’importante migration de Grande-Bretagne venant évangéliser l’Armorique. Il débarque sur la petite île de Cézembre, au large d’Aleth, rejoignant alors sur ce minuscule ilot, l’ermite breton Aaron, où celui-ci s’était retiré, à l’abri des tentations du monde. À la mort d’Aaron, en 541, cet ilot, appelé le « rocher d’Aaron » devint alors le rocher de Saint-Malo. Son compagnon décédé, Malo quitta Cézembre pour venir s’installer à Aleth où il allait fonder un monastère. Il en aurait été élu évêque en 590.Mais, entré en conflit avec les habitants d’Aleth, Malo quitta la ville pour Saintes, où il mourut un 15 novembre vers l’an 621. Ses reliques furent transférées en 672 à la cathédrale d’Aleth et à l’ermitage de Saint-Aaron. Enfin, lors de l’invasion normande au Xe siècle, elles furent transportées à Paris, puis à Montreuil avant d’être dispersées. Après la révolution française, la réorganisation des 7 évêchés de Bretagne en 5 diocèses eut pour conséquence de réunir dans un seul, Dol et St Malo autour de Rennes. Si l’évêché d’Aleth a disparu, St Malo -ou St Maclou- est resté bien présent, grâce aux nombreuses églises portant cette appellation, sans oublier les rues, quartiers et bien sûr la ville elle-même, tous participent à leur manière à la mémoire de notre dernier Saint fondateur. Michel HINAULT (sources multiples)
Les Saints fondateurs de la Bretagne
Les Saints fondateurs de la Bretagne
Selon la tradition et selon une vie de saints (hagiographie) tardive, écrite à partir du XIe siècle, les sept saints fondateurs de la Bretagne seraient des moines et ermites venus du Pays de Galles et de Cornouailles vers le 5e siècle et le 6e siècle, à l’époque de l’émigration bretonne (Grande Bretagne). L’évangélisation de notre province (Armorique) se serait alors établie autour des monastères fondés à cette époque.
St Patern Évêque de Vannes
Abbé en Bretagne au 5e siècle. Fêté le 15 avril.

Il est mentionné également sous l’appellation de « Patern l’ancien » pour le différencier des autres saints Patern, nombreux de par le monde et en particulier de celui du diocèse de Coutances et d’Avranches. Dans l’Ouest, des églises lui sont dédiées en particulier dans le Calvados, la Manche ou en Ille-et-Vilaine. Certaines communes de France portent également ce nom. Pour « notre St Patern breton », il existe deux versions de ses origines mais elles se rejoignent cependant dans le comté de Cardigan, au Pays de Galles. (Grande Bretagne)
Une première source, nous indique que, contrairement aux autres saints fondateurs, il serait parti de Bretagne pour fonder dans ce comté ( Cardigan) un monastère qui porte d’ailleurs son nom « Lhan-Paderne-Vaur » (église du grand Paterne) et c’est au cours d’un pèlerinage à Jérusalem qu’il aurait reçu la consécration épiscopale. L’autre source le situe également à Cardigan mais, comme pour les autres saints fondateurs, c’est de cette région qu’il serait parti comme Abbé, pour rejoindre l’Armorique. Il serait devenu évêque, en Bretagne, lors d’un concile … de Vannes ou de Tours. ? Quoiqu’il en soit, devenu évêque, le chef local Caradeuc lui confia l’évêché de Vannes.
Son ministère, que l’on situe entre 461 et 490, sera marqué par des conflits internes à l’Église et sont restés dans les mémoires ; conflits où s’opposeront une forme de christianisme de tradition celte et les partisans d’un christianisme gallo-romain. Victime de ces divisions, Pattern sera contraint de s’exiler et mourra, inconnu, en ermite.
C’est en 1964 que le pape Paul VI a déclaré Saint Patern, patron du diocèse de Vannes et a fixé sa fête liturgique, chaque année, le 15 avril. À Vannes même, tout un quartier et son église lui sont également dédiés. St Patern, dit-on, serait invoqué pour obtenir la pluie ! Pas sûr que les bretons l’invoquent souvent !
Michel HINAULT (sources multiples)
Les Saints fondateurs de la Bretagne
Les Saints fondateurs de la Bretagne
Selon la tradition et selon une vie de saints (hagiographie) tardive, écrite à partir du XIe siècle, les sept saints fondateurs de la Bretagne seraient des moines et ermites venus du Pays de Galles et de Cornouailles vers le 5e siècle et le 6e siècle, à l’époque de l’émigration bretonne (Grande Bretagne). L’évangélisation de notre province (Armorique) se serait alors établie autour des monastères fondés à cette époque.
St Samson ( Samzun) fêté le 28 juillet
Évêque de Dol-de-Bretagne au VIe siècle Diocèse de Rennes, Saint Malo et Dol Département d’Ille et Vilaine
St Samson est le patron de Dol-de-Bretagne, ancienne ville épiscopale jusqu’à la Révolution.

L’évêché a fusionné en 1801 avec l’archevêché de Rennes. Il a donné son nom à Saint-Samson-sur-Rance et est vénéré dans de nombreux lieux en Bretagne, en Normandie et au Pays de Galles. Samson est une grande figure de la Bible, un juge doté d’une force prodigieuse. Ce nom s’est répandu dans la chrétienté, et le nôtre est un gallois venu en Armorique au VIe siècle. Il naquit vers 480 dans le Clamorgan (Galles du sud). Son père, un noble, aurait désiré pour lui le métier des armes, mais l’enfant était porté vers les « choses de Dieu » et il devint disciple de Saint Iltud où il rencontra sans doute Saint Brieuc et Saint Pol Aurélien. Devenu évêque, il rejoignit l’Armorique avec quelques compagnons et il débarqua près de Cancale. À son arrivée, il guérit la femme et la fille d’un seigneur local qui lui donna en récompense des terres où il fonda un monastère et un évêché qui est devenu Dol-de-Bretagne. La particularité de ce diocèse, c’est qu’il était constitué de plusieurs petits territoires répartis sur la côte Nord de la Bretagne,

du Léon à la Normandie. Saint Samson contribua grandement à évangéliser la Domnonée (partie nord de l’Armorique). Après avoir choisi son successeur, le moine Magloire, il mourut le 28 juillet 565. Un siècle plus tard, l’un de ses admirateurs que nous connaissons comme patron de Coëtlogon, Saint Thuriau, devint lui aussi évêque de Dol. Lors des invasions Wickings au IXe siècle, ses reliques furent transférées à Orléans et à Paris avant de revenir à Dol où elles furent protégées lors de la Révolution et où nous pouvons encore les vénérer sur le chemin du Tro Breiz. À noter qu’aujourd’hui, le célèbre écrivain Ken Follett, auteur du roman « Les Piliers de la Terre », est gallois comme Saint Samson et participe activement et financièrement à la restauration de la cathédrale.
Michel BLANCHARD (d’après différentes sources)
Les saints patrons de l’Europe
Les saints patrons de l’Europe
Les Saints sont ceux qui ont pendant leur vie terrestre noué une telle amitié avec Dieu qu’ils nous ont donné à voir quelques chose de l’amour de Dieu autour d’eux. Il est dans la tradition de l’Église catholique de mettre des territoires sous la protection particulière d’un(e) saint(e). C’est ainsi qu’ont été choisis des saints patrons européens dont la sainteté s’est exprimée dans des circonstances historiques et dans un contexte géographique qui les rendent significatifs pour le continent européen. Ils sont au nombre de six co-patrons de l’Europe.
1- St Benoît de Nursie (bulletin de Novembre 2024)
2- Ste Brigitte de Suède (bulletin de Décembre 2024)
3 et 4-Saints Cyrille et Méthode, évêques slaves

fêtés le 14 février
Témoins de l’Église, fidèles au pape comme au patriarche de Constantinople, Cyrille et Méthode , deux frères, ont été nommés co-patrons de l’Europe en 1980 par le pape Jean-Paul II.
Apôtres des slaves au 9e siècle, ils sont fêtés ensemble le 14 février dans le martyrologe romain et le 11 mai dans les Églises d’Orient. Nés à Thessalonique en Grèce, Méthode, d’abord nommé Michel, en 825, et son petit frère, Cyrille, d’abord nommé Constantin, en 829, sont envoyés en mission par le patriarche de Constantinople chez les Khazars en Asie, puis en Moravie, une possession allemande dans l’actuelle Tchéquie, pour évangéliser les peuples slaves. Cyrille crée un nouvel alphabet issu du grec pour l’adapter à la langue slave, « le slavon ». Devenu l’alphabet cyrillique, il est utilisé dans plusieurs pays slaves, dont la Russie, l’Ukraine, la Bulgarie et d’autres.
Persécutés par les clercs germaniques qui leur reprochent de brader les textes sacrés, ils sont soutenus par le pape Hadrien II. Cyrille meurt à Rome en 869 et Méthode continue l’évangélisation de son frère en Moravie et Pannonie (Slovaquie actuelle).
Les deux frères sont ainsi considérés comme les témoins d’une « Église unie dans la diversité des rites et des langues », un véritable modèle d’inculturation. La devise actuelle de l’Europe s’en est largement inspirée.
Cyrille et Méthode avaient compris qu’un peuple ne peut considérer avoir reçu pleinement le message du christianisme

avant de l’avoir entendu et-lu dans sa propre langue. En cela, l’Église européenne, en particulier, voit dans l’action et le ministère de ces deux saints une source d’inspiration toujours actuelle.
Méthode, mort en 885, est enterré dans la cathédrale de Véléhrad à Prague (Tchéquie) et le corps de Cyrille a été ramené à Salonique (Grèce) en 1076. Cathédrale de Prague
Michel Blanchard
Loudéac sur InfoBretagne
Loudéac viendrait du latin « lucotius », nom d’homme gaulois, semble-t-il. Loudéac est un démembrement de l’ancienne paroisse primitive de Cadelac. Cadelac, jadis chef-lieu d’une paroisse, est attestée aux XIIIe et XIVe siècles : Eon Quenandu est recteur de Kadellac en 1302 et en 1246, on trouve un chevalier du nom de Geffroy de Cadellac.
Plemet sur InfoBretagne
Plémet tire son nom de saint Démet, d’origine galloise et ayant vécu dans la région de Brest.
Saint Cado
Les SAINTS de nos paroisses

SAINT CADO
Chapelle à Cadélac et fontaine à Saint Hovec en Loudéac.
Fils d’un prince de Glamorgan en Pays de Galles (Grande Bretagne), puis fondateur et abbé du grand monastère de Liancarvann, saint Cado vint en Armorique, comme tant d’autres moines de son pays à une époque non déterminée qui se situe du Ve au VIIe siècle. Il accompagnait ou venait retrouver ses compatriotes chassés par l’invasion saxonne. Il s’habitua dans l’Ile de la rivière d’Etel qui porte son nom. Il y construisit un oratoire, fonda un monastère et se consacra à l’évangélisation du pays. Son influence y fut très importante.
Le monastère de Saint Cado prit une certaine importance sans que l’on puisse affirmer que ce fut du vivant de son fondateur.
Un jour, l’île fut envahie par les pirates qui la dévastèrent et en chassèrent saint Cado. Celui-ci retourna dans son pays d’origine où il se fit remarquer par ses œuvres de charité et plus tard fut sacré évêque de Benevent près de Naples. Il mourut martyr.
A Cadélac, la chapelle saint Cado a été construite en 1930 à l’emplacement de l’ancienne église paroissiale détruite en 1807. Saint Cado est honoré depuis longtemps car les registres paroissiaux nous apprennent que « le 3e jour de septembre 1635, fut haussé et refait l’autel de saint Cado », puis « en 1694, le samedi 25 septembre, on inaugura le retable de l’autel saint Cado ».
Les pélerins venaient naguère nombreux du Morbihan et du pays Gallo pour demander au Saint de guérir leurs membres ankylosés, les maux d’yeux et d’oreilles, les plaies et les maladies cutanées tels les furoncles.
En 1917, et plus tard sans doute, l’oratoire contenait encore quantité de béquilles et de bâtons laissés sur place par les malades reconnaissants.
La méthode était simple. Il fallait appliquer de la boue sur le côté de la fontaine et lorsque la boue séchée tombait, le mal tombait.
Cette année, le pardon aura lieu le dimanche 29 août.
Saint Marcel 1er Pape et martyr, à St Caradec
Les Saints de nos paroisses }}}

Le nom de Marcel dérive de Marc qui signifie « manteau » en latin. Une vingtaine de saints portent ce nom. On célèbre notamment des Marcel, les 29 octobre et 19 avril. Celui dont nous parlons dans ce texte fut le Pape Marcel 1er, natif de Rome et 30e successeur de Saint Pierre du 27 mai 308 au 16 janvier 309. Il succédait à Marcellin (296-304) après quatre ans de vacance du siège pontifical, à une époque où les persécutions contre les chrétiens étaient très violentes sous l’empereur Dioclétien.
Devenu Pape, saint Marcel n’oublia point les exemples de vertus et de courage de son prédécesseur. Il obtint d’une pieuse matrone nommée Priscille, un endroit favorable pour y rétablir les catacombes nouvelles, et pour pouvoir y célébrer les divins mystères à l’abri des profanations des païens. Les vingt-cinq titres de la ville de Rome furent érigés en autant de paroisses distinctes, afin que les secours de la religion fussent plus facilement distribués aux fidèles. À la faveur d’une trêve dans la persécution, Marcel s’efforça de rétablir la discipline que les troubles précédents avaient altérée. Sa juste sévérité pour les chrétiens qui avaient apostasié durant la persécution lui attira beaucoup de difficultés.
L’Église subissait alors la plus violente des dix persécutions. Dioclétien venait d’abdiquer en 305, après avoir divisé ses États en quatre parties, dont chacune avait à sa tête un César. Maxence, devenu César de Rome en 306, ne pouvait épargner le chef de l’Église universelle. L’activité du Saint Pontife pour la réorganisation du culte sacré au milieu de la persécution qui partout faisait rage, était aux yeux du cruel persécuteur, un grief de plus.

Maxence le fit arrêter par ses soldats et comparaître à son tribunal, où il lui ordonna de renoncer à sa charge et de sacrifier aux idoles. Mais ce fut en vain : saint Marcel répondit hardiment qu’il ne pouvait désister un poste où Dieu Lui-même l’avait placé et que la foi lui était plus chère que la vie. Le tyran, exaspéré par la résistance du Saint à ses promesses comme à ses menaces, le fit flageller cruellement. Il ne le condamna point pourtant à la mort ; pour humilier davantage l’Église et les fidèles, il l’astreignit à servir comme esclave dans les écuries impériales. Marcel 1er est probablement mort le 16 janvier 309 et aurait été enseveli à Rome, dans la catacombe de Priscille où reposent de nombreux martyrs. Il a été canonisé et il est fêté le 16 janvier. Il est le saint patron des grainetiers.
Saint Marcel est le Saint patron d’une commune et d’une paroisse dans le Morbihan. Il est aussi celui dont nous trouvons la statue dans la Chapelle de Saint Marcel à Saint-Caradec.
Père Jean-Marie KALOMBO
Saint Ronan
Les SAINTS de nos paroisses
SAINT RONANhttps://www.zonedeloudeac.catholique.fr/sites/zonedeloudeac.catholique.fr/IMG/arton342.jpg
Saint Ronan est un moine irlandais qui vécut au VIe siècle. Arrivé de son île, il parcourut d’abord le pays du Léon avant d’installer son ermitage en Cornouaille tout près de Locronan (Finistère sud) dans la forêt du Névet.
La vie de Saint Ronan rapporte plusieurs faits légendaires et miracles à son sujet, notamment celui-ci.
Lorsqu’il vivait près de Locronan, il vit surgir un loup tenant dans sa gueule un mouton et poursuivi par un homme pleurant de douleur. Ronan le prit en pitié et pria Dieu de sauver le mouton.
Aussitôt le mouton se retrouva aux pieds de Ronan et du propriétaire. Celui-ci alla souvent voir Ronan ensuite pour qu’il lui parle de Dieu. Mais sa femme, Kében, injuria Ronan et l’accusa d’avoir ensorcelé sa famille. Elle lui demanda de ne plus les voir sans quoi elle le châtierait. Elle prépara un plan. Elle alla voir le roi Gradlon et accusa Ronan d’avoir tué sa fille. Le roi ordonna alors d’enfermer Ronan à Quimper. Puis on l’attacha à un arbre et on lâcha sur lui deux chiens sauvages et affamés. Sans s’émouvoir, Ronan fit un signe de croix sur son cœur. Aussitôt les chiens s’enfuirent.
Ronan quitta sa forêt pour parcourir la Bretagne. Il serait passé par Laurenan avant de se rendre à Hillion (Saint René) où il mourut. Son corps fut ramené à Locronan où il fut inhumé. Aujourd’hui on peut voir son tombeau dans la chapelle du Pénity à l’intérieur de l’église paroissiale.
Le culte de Saint Ronan se développa à partir du Xe siècle. Plusieurs lieux portent le nom : Saint Renan, Locronan, Laurenan, Saint René. Une chapelle lui est dédiée à Plozevet (Finistère). À Laurenan, on fait mention de son pardon dès avant 1800. Ce pardon avait traditionnellement lieu le 1er juin, il rassemblait les fidèles lors de la messe solennelle et des vêpres.
L’église actuelle de Laurenan lui est aussi dédiée. Construite à partir de 1869 à l’emplacement d’un édifice devenu trop petit pour accueillir toute la population, elle fut achevée et consacrée en 1872.
Locronan continue de célébrer le saint à l’occasion de pardon beaucoup plus conséquents : les troménies. Chaque année en juillet, statues et bannières sont portées à travers la campagne sur un parcours de 6 km (petite troménie) ou 13 km (grande troménie). Cette dernière se déroule tous les 6 ans. Le parcours fait le tour de l’espace fréquenté par saint Ronan durant sa vie à Locronan.
Bernard Rouillé
St Laurent
Les SAINTS de nos paroisses

St Laurent †258
Chapelle et fontaine au lieu-dit St-Laurent en Plémy Chapelle et fontaine au lieu-dit St-Joret en St-CaradecFontaine près du centre bourg à La Ferrière
Fêté le 10 août ou le dimanche le plus proche.
Au Moyen Âge, c’était l’un des martyrs les plus célèbres de la chrétienté. Avec St Pierre et St Paul, il était le patron de Rome et aujourd’hui encore de nombreuses églises lui sont dédiées. En Espagneégalement, où il est né, on a même construit en son honneur un château en forme de gril -l’Escurial -. En France, 84 Communes portent son nom associé aux caractéristiques de la commune (de la mer, sur sèvre, etc…
Sa renommée tient d’abord à son histoire assez exceptionnelle.
Comme on le sait sans doute, le culte chrétien ayant été interdit, St Laurent, diacre auprès du Pape Sixte III, fut comme lui condamné à mort au 3e siècle. En effet, gardien des biens et trésors de l’Église, plutôt que de les voir confisqués par l’empereur, il distribua ces richesses aux pauvres de la ville. Une autre tradition, mais au même résultat, rapporte qu’il rassembla tous les pauvres, infirmes, boiteux et les présenta ainsi « Voilà les trésors de l’Église ». Ayant ainsi bafoué l’autorité impériale, il fut torturé et rôti à petit feu sur un gril en fer. C’est pourquoi on le représente le plus souvent, comme ici sur cette photo, tenant d’une main un gril et de l’autre le livre des évangiles.
St Laurent guérisseur.
C’est sans doute pour cette raison également que la tradition a attribué à St Laurent le don de guérir brûlures et maladies de peau. Bien souvent, près des chapelles qui lui sont dédiées, se trouve aussi la fontaine avec la cuillère pour que les pèlerins y puisent l’eau ou la boue bienfaitrice. Naturellement aussi St Laurent est invoqué afin de se protéger des incendies. Il est devenu de fait le saint patron des pompiers, des rôtisseurs, des charbonniers et autres bénévoles responsables des barbecues festifs ou familiaux.
St Pol Aurélien (Paol)
🙂 Évêque de St Pol de Léon au VIe siècle
Diocèse de Quimper et Léon Département du Finistère.
St Pol Aurélien est le patron de St Pol de Léon, ancienne ville épiscopale jusqu’à la Révolution. L’évêché a fusionné en 1790 avec l’évêché de Cornouaille pour former celui de Quimper et Léon. Plusieurs lieux portent le nom de St Pol : Lampaul-Ploudalmézeau, Mespaul, Lampaul, le bourg de l’île d’Ouessant et bien d’autres.
Pol Aurélien vint du Pays de Galles au VIe siècle pour évangéliser la Domnonée, Bretagne actuelle. Il

naquit vers 492 et son père, qui était noble aurait voulu pour lui, le métier des armes, mais Pol choisit d’étudier à l’école monastique de St Iltud où il rencontra sans doute Samson, Malo, Brieuc et Guirec, bien connus chez nous. Plus tard, il traversa la Manche avec des compagnons et aborda à l’île d’Ouessant. Puis il alla fonder un ermitage à l’île de Batz où sévissait un dragon (d’après la légende). Alors revêtu de son étole qu’il enroula autour du cou du dragon, il emmena ce dernier au bord de la falaise et il lui ordonna de se jeter à la mer et ainsi disparut le dragon.
Pol fonda un évêché dans la cité de Léon et c’est ainsi qu’il est devenu l’un des sept fondateurs de la Bretagne. Par la suite, sentant ses forces décliner, il se retira sur son île de Batz-Pol où il rendit son âme à Dieu le 12 mars 572. Après sa mort, les habitants de l’île voulurent garder son corps. Alors ils mirent le cercueil sur un chariot tiré par deux bœufs qui s’arrêtèrent devant la cathédrale où il fut inhumé.

Dans la cathédrale se trouve aussi la cloche en cuivre qui avait été apportée à St Pol par un poisson. Elle est utilisée pour guérir de la surdité. Lors des invasions Wickings au IXe siècle, ses reliques furent transférées au monastère de Sully-sur-Loire. Seul un os d’un bras se trouve aujourd’hui dans le reliquaire de la cathédrale que peuvent vénérer les pèlerins du Tro-Breiz et les autres. Pol ou Polig est toujours un prénom répandu en Bretagne. Michel BLANCHARD (d’après différentes sources)




